 Un intermède parisien
Un intermède parisien"Liliom" est tout d'abord l'oeuvre d'un écrivain hongrois : Ferenc Molnar (1878, Budapest - 1952, New-York), romancier réaliste ("Les garçons de la rue Pal", 1907) et auteur dramatique ("Liliom", 1909). L'adaptation féerique est l'oeuvre de Fritz Lang et de Robert Liebmann. On retrouve ici le côté fantastique présent dans "Les 3 lumières". L'oeuvre de Lang exprime le réalisme poétique teinté de fantastique social. Nous retrouvons l'univers de Renoir (le drame gai, le "ni noir, ni blanc"), de Clair (légèreté musicale, humour populaire), de Duvivier (mythe du mauvais garçon avec Gabin). Mais Lang a su ajouter sur l'écran du cinéma français cette originalité que lui valent sa culture et son expérience propre. Ce que Biette désignait en parlant du cinéma hollywoodien, et entre autre de Lang, comme apport spécifique du réalisateur immigré transformant la règle vaudrait aussi pour son passage dans le paysage français du réalisme poétique.

Dans la première partie du film, les points de vue ne sont pas réellement spécifiés. Nous sommes la plupart du temps en focalisation zéro. Par contre, il est clair que dans la seconde, la focalisation interne nous donne à voir le point de vue de Liliom mais aussi le point de vue de son interlocuteur que l'on qualifiera de "juge". Ce terme n'est pas réellement approprié mais nous l'utilisons pour l'instant pour ne pas déflorer le traitement que nous en ferons. Les syntagmes sont chronologiques et de type "narratif alterné" dans la première partie du film. Par contre, la seconde partie, qui commence presque sur une ellipse de 16 ans, est de type linéaire.
Les dialogues de Bernard Zimmer donnent une caractérisation sociolectes des personnages. Les acteurs respectent la prononciation patoisante des "titis" parisiens (Liliom, Mme Moscat,...). Les chansons populaires sont le contrepoint sonore de cette caractérisation ("Viens gosse de gosse",...) tout comme la bande-son de la fête foraine (les rires, le piano mécanique,...). Au sujet de la temporalité, bien que nous basculons dans un univers fantastique, nous pouvons toujours daté le récit : la convocation de Liliom, point de repère temporel du film, les 16 années de purgatoire.
Le générique


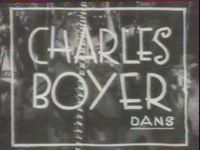

Il campe l'univers de Liliom : la foire (voir le thème "La fête foraine" pour le descriptif de la structure et des thèmes abordés). Il n'y a pas de rupture entre le générique et le premier plan du film, en légère plongée, du manège, début réel du récit.
Le générique pose le registre sonore et inscrit le leitmotiv musical de la chanson "gosse de gosse". Tout comme M et le Peer Gynt, Lang associe son héros à un thème musical mais il s'agit plus d'une caractérisation sociale et poétique.
Les décors
Le tournage en studios donne au réel intra-diégétique un aspect poético-fantastique. Même la scène où Liliom s'élève dans le ciel nous donne à voir un Paris fait de décors et de surimpressions qui le magnifie d'une façon onirique. Le tournage en décors de studio permet également à Lang de respecter le climat théâtral de l'oeuvre.
Acteurs et personnages

 Le jeu des acteurs est assez théâtral ce qui, conjointement à la lumière de Lang et à ses décors, les baignent dans un univers fait de poésie qui semble parfois un peu surnaturel, sans doute à desseins. Les relations actancielles des personnages fonctionnent en duo. Une troisième personne vient toujours s'inscrire à l'intérieur du couple mais le trio ne fonctionne jamais. L'exception est donnée à la fin : Liliom et les deux Julie. Lang fait ainsi vibrer notre émotion sur la notion de famille. Toute l'habileté de Lang réside dans le fait qu'il nous le communique sans le dire explicitement.
Le jeu des acteurs est assez théâtral ce qui, conjointement à la lumière de Lang et à ses décors, les baignent dans un univers fait de poésie qui semble parfois un peu surnaturel, sans doute à desseins. Les relations actancielles des personnages fonctionnent en duo. Une troisième personne vient toujours s'inscrire à l'intérieur du couple mais le trio ne fonctionne jamais. L'exception est donnée à la fin : Liliom et les deux Julie. Lang fait ainsi vibrer notre émotion sur la notion de famille. Toute l'habileté de Lang réside dans le fait qu'il nous le communique sans le dire explicitement. Les trios sont :
- Mme Moscat, Liliom, Julie
- Liliom, l'amiral, Hollinger
- Julie, son amie, Mme Moscat
- Julie, son amie, Liliom
- Julie, Liliom, la tante
- Julie, la tante, M. Tourneur
- Alfred, Liliom, le rémouleur (joué par Antonin Artaud)
- Alfred, Lilom, le policier
- Julie, sa fille, Liliom
Les thèmes
L'amour
C'est le thème prédominant du film. Plus qu'à Julie, c'est surtout à Liliom qu'il est associé. La raison du succès de l'Hippo-palace, c'est l'amour que les ravissantes portent à Liliom. Le thème de l'amour est tout d'abord véhiculé par la chanson. Le registre de l'époque est riche en romances sentimentales.
 Lorsque Liliom demande un titre, on lui répond : "gueule d'amour", "paradis d'amour", "chagrin d'amour", "parlez-moi d'amour". Il est amusant de noter que la seule pour laquelle il montrera un intérêt lui propose un titre qui n'évoque pas ce thème ("gosse de gosse" dont les paroles sont néanmoins du registre amoureux). Les guirlandes qu'on jette sur le manège et qui semblent former des coeurs, les figurines d'Adam et Eve : dès le départ le thème de l'amour est inscrit. Le parallèle entre les statuettes et le couple Liliom-Julie va commencer à s'inscrire plus frontalement. Ainsi le jeu de la pivoine se concrétise par un gros plan des dites statuettes alors que, juste avant, Julie aura posé son visage dans le cou de Liliom. Et c'est Liliom, un peu plus tard, qui enverra d'un coup de pied le couteau se planter dans la pomme ! Parallèle également entre la progression de leur rencontre et le texte de la chanson : "Sur les chevaux de bois on sera bien mieux" : plan serré de Liliom tenant Julie par la taille. Suit un plan de l'amiral puis un plan serré de Liliom et Julie qui, dans le mutisme, reflétent exactement les paroles que l'on entend à ce moment : "Toi contre moi, les yeux dans les yeux". Il est à noter que le reste des paroles est un indice de prévisibilité du destin de Liliom : "Et l'on croit faire un beau rêve alors on croit s'envoler joyeux vers les cieux". Plus tard, une ouverture au noir se fait sur un coeur gravé dans lequel sont inscrits leurs deux prénoms. Puis d'autres coeurs viennent se superposer en enchaîné, signe d'ellipse temporelle qui rend compte aussi de l'éphémère des promesses d'amour. Lorsque Liliom ira jouer aux cartes avec Alfred, on retrouvera le motif de l'amour sur les soucoupes : île d'amour, ville d'amour. Lorsque Liliom se suicide, il crie le prénom de Julie comme seul mot d'amour qu'il saura exprimer. Le plan suivant montre Julie qui, par télépathie, parte la main à son coeur. Elle a entendu Liliom. L'amour les unit bien.
Lorsque Liliom demande un titre, on lui répond : "gueule d'amour", "paradis d'amour", "chagrin d'amour", "parlez-moi d'amour". Il est amusant de noter que la seule pour laquelle il montrera un intérêt lui propose un titre qui n'évoque pas ce thème ("gosse de gosse" dont les paroles sont néanmoins du registre amoureux). Les guirlandes qu'on jette sur le manège et qui semblent former des coeurs, les figurines d'Adam et Eve : dès le départ le thème de l'amour est inscrit. Le parallèle entre les statuettes et le couple Liliom-Julie va commencer à s'inscrire plus frontalement. Ainsi le jeu de la pivoine se concrétise par un gros plan des dites statuettes alors que, juste avant, Julie aura posé son visage dans le cou de Liliom. Et c'est Liliom, un peu plus tard, qui enverra d'un coup de pied le couteau se planter dans la pomme ! Parallèle également entre la progression de leur rencontre et le texte de la chanson : "Sur les chevaux de bois on sera bien mieux" : plan serré de Liliom tenant Julie par la taille. Suit un plan de l'amiral puis un plan serré de Liliom et Julie qui, dans le mutisme, reflétent exactement les paroles que l'on entend à ce moment : "Toi contre moi, les yeux dans les yeux". Il est à noter que le reste des paroles est un indice de prévisibilité du destin de Liliom : "Et l'on croit faire un beau rêve alors on croit s'envoler joyeux vers les cieux". Plus tard, une ouverture au noir se fait sur un coeur gravé dans lequel sont inscrits leurs deux prénoms. Puis d'autres coeurs viennent se superposer en enchaîné, signe d'ellipse temporelle qui rend compte aussi de l'éphémère des promesses d'amour. Lorsque Liliom ira jouer aux cartes avec Alfred, on retrouvera le motif de l'amour sur les soucoupes : île d'amour, ville d'amour. Lorsque Liliom se suicide, il crie le prénom de Julie comme seul mot d'amour qu'il saura exprimer. Le plan suivant montre Julie qui, par télépathie, parte la main à son coeur. Elle a entendu Liliom. L'amour les unit bien.Alors qu'il est mort, Julie avoue à Liliom qu'elle regrette de ne pas lui avoir avoué qu'elle l'aimait. Après sa mort, Julie garnira la photo de Liliom de deux bougies en forme de coeur. La leçon et donnée également là-haut à Liliom : "Dieu n'a pas mis l'amour dans le coeur des hommes pour qu'ils en aient honte". En fait, l'amour entre Liliom et Julie n'a pas pu s'exprimer aussi s'est-il traduit par une réaction agressive de la part de Liliom et pour Julie par un asservissement et un mutisme qui ne tenteront de se lever que deux fois par une rébellion et une fois par un aveu posthume. C'est la tragédie des malentendus que la mort féerique de Liliom et le charme de Julie transforment en poésie mélancolique. On ne peut s'empêcher de penser au traitement tout aussi poétique et féérique qui est fait de la mort dans "Les trois lumières".
Le mauvais garçon
Le héros de "M le maudit" était un petit bourgeois, un employé tranquille qui cachait finalement un monstre. Avec "L le loubard", nous abordons le mythe du mauvais garçon, du refoulé de la société qui découvre un coeur d'or quand on lui donne la chance de l'exprimer. Le mythe du mauvais garçon créé avec Gabin par Duvivier dans les années 30 est ici illustré d'une façon tout aussi magistrale par Charles Boyer. C'est un tempérament physiquement solide mais marqué par la fatalité, mythologie de l'homme qui ne peut se fixer socialement, qui connaît des amours impossibles. Mythologie associée à la chiennerie de la vie et à une mort violente. Le mythe du mauvais garçon est avant tout dans ce film le corollaire du mythe de l'amour difficile. Liliom caractérise également le mauvais garçon par d'autres aspects.

Le mauvais garçon se bat
Le mauvais garçon se bat mais il considère les rixes comme un jeu. Ainsi dès le générique, le monde ludique de la foire est illustré par un homme tapant dans un punching-ball. Lors de la querelle entre Hollinger et Liliom, les gens s'amusent, rient et observent la bagarre comme s'il s'agissait d'un spectacle. C'est le silence complet quand Hollinger sort son couteau, signe d'un épisode inhabituel : on va rarement aussi loin. Cet épisode relève une fois de plus la grande maîtrise de fritz Lang dans l'art de la mise en scène. Quand Lang nous donne à voir par un panoramique le plan de la foule soudainement apeuré, que la bande son devient muette, nous comprenons le drame mais Lang ne nous le donne pas encore à voir, créant ainsi un effet de suspense. Il nous donne à voir l'effet (l'émotion des gens) avant la cause (le motif d'émotion : le couteau) en opérant un renversement. Un panoramique inverse montre en effet Hollinger et le couteau. Hollinger n'est pas un mauvais garçon, c'est un méchant. Ce n'est pas pareil. Liliom, lui, refuse le meurtre. Ainsi il suggère à Alfred qu'il n'est peut-être pas utile de commettre un crime lors de la préparation du vol. Il traite même Alfred de "dégueulasse" après le passage du rémouleur.
Tandis que Liliom se bat avec le torpilleur, Mme Moscat cherche querelle à Julie et à son amie. Elle a une attitude assez machiste si bien qu'on peut considérer qu'elle est aussi quelque part un mauvais garçon. D'ailleurs elle utilise les mêmes codes que Liliom. Ainsi quand Liliom termine avec son rival, il crache dans sa main avant de lui mettre l'estoquade finale. Mme Moscat crachera aussi dans sa main droite avant de frictionner la tête de Liliom.
Le mauvais garçon est un séducteur
Il flatte les femmes car il sait qu'elles sont les garantes de sa popularité : "au rendez-vous de l'élégance et de la beauté", "vise un peu ces ravissantes, tu n'en trouveras pas de plus belles ailleurs". Il fait les yeux doux à toutes les femmes. Il flatte également la serveuse du café "L'île d'amour" pour obtenir d'elle quelques menues monnaies. Au ciel dans le bureau du commissaire, c'est la petite musique légère d'un xylophone (métaphore de la féminité) qui, venant du hors-champ, interpellera Liliom. Le plan suivant nous est donné dans cette continuité sonore et nous découvrons une élégante secrétaire que Liliom s'empresse de séduire.
Le mauvais garçon est cynique
ll flatte les femmes par intérêt mais ne cache pas un certain cynisme à leur égard. La dame habillée avec un manteau à carreaux droits doit s'asseoir sur le zèbre. "Serrez les genoux, attention aux bas de soie" leur dit-il tout en rabaissant quelques jupes au passage. Il est séduit par leur féminité mais en même temps, il en a peur. Lorsqu'il retrouve Julie et sa copine, il leur dit : "Encore là toutes les deux ? Mais je n'en ai invité qu'une!". Nous retrouvons encore le cynisme teinté de peur. Cela prouve son immaturité. Liliom n'assume pas sa relation avec les femmes.
Le mauvais garçon est bien sûr cynique avec les institutions
Il figure l'anarchiste qui refuse les interdits : "Ce serait plus court de dire ce qu'on a le droit de faire". Ce cynisme est le reflet de celui de Lang qui exagère les panneaux d'interdiction, qui exagère aussi le temps d'attente. La procédure du timbre humide ridiculise l'administration. Fritz Lang est obsédé par le problème de l'individu face aux rouages de la société et de la justice qui lui semblent souvent monstrueux ("M le maudit"). Lors de la rafle près du port, les policiers ont l'air de vrais bandits : pas rasés, la cravate mal ajustée. Il apparaît que leur seule compétence est de savoir distinguer les mains des employées de chambre de celles des bonnes à tout faire. C'est un jugement très ironique sur leur pespicacité. En même temps Lang introduit le thème de la fatalité inscrite jusque dans les mains, trace dont on ne se débarasse pas.
Le cynisme de Liliom se rejouera au ciel quand il constatera que le haut et le bas sont identiques. Mais l'expérience sur terre a servi l'homme : il sait maintenant où sont les timbres humides ! Le cynisme des petites gens vis à vis des institutions est exprimé également au café où une jeune femme dit ouvertement qu'elle ne déclare pas ses revenus. A la façon claire et franche dont elle s'exprime, on comprend cette révélation comme un mode de vie parallèle, celui des petites gens obligés de tricher pour s'en sortir.

Le mauvais garçon ne voit pas le travail comme une vertu
Il serait assez partisan du droit à la paresse exprimé par Paul Lafargue. Liliom aime travailler au manège car il s'agit plus d'un jeu. Mais il refuse d'être concierge non seulement car il se déclare artiste mais aussi car il serait alors l'esclave de ses locataires. Comme il n'accepte visiblement pas l'idée de Dieu (Il dit : "maintenant que je suis mort, qu'on me laisse tranquille", il n'emploie pas le mot Dieu, signe qu'il ne le reconnaît pas) et qu'il n'accepte pas d'être employé (Quand Mme Moscat rappellera leurs rapports de force, il la quittera), on peut suggérer qu'il a un penchant anarchiste se ralliant au "Ni Dieu ni maître".
Et donc le mauvais garçon est cynique vis à vis des bourgeois
Ainsi quand Liliom bouscule M. Tourneur, il se retourne pour l'insulter. Aucune concession pour la bourgeoisie. Le cocasse de la situation est la réplique de M. Tourneur qui, le comble, s'excuse.
La fête foraine
L'univers de la fête foraine nous est donné dès le générique. C'est un homme qu'on ne voit pas qui lance le film. Cette voix peut suggérer celle du metteur en scène. Nous découvrons toutes les attractions de la fête, lieu d'amusement qui réunit hommes, femmes et enfants. Les ballons s'élèvent dans le ciel comme plus tard le fera Liliom. La grande roue tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, comme si nous étions en dehors du temps. On dirait que les wagons du grand huit vont crever l'écran, renforçant l'impression de réel qui provoque l'adhésion immédiate. Les plans du générique sont très courts et très rythmés par un montage qui fait s'intercaler des personnages et des objets de foire : un homme de foire - le manège des assiettes - un dos tatoué de lutteur - fondu rapide sur les gamins ébahis - un tireur à la carabine dans le côté gauche du cadre - les pipes à casser sur un support en étoile - une femme tient maintenant la carabine dans le côté droit du cadre pour créer une symétrie avec l'homme - un automate tapant sur un tambour - une balle roulant au bout d'un jet d'eau. A ce moment la chanson "Gosse de gosse" jouée à l'orgue mécanique, leitmotiv musical du film, est recouverte par une musique accélérée. Le motif du cercle apparaît : le boxeur et son punching-ball - les ballons dans le ciel -

la grande roue - un plateau rond tournant avec les quatre as - un anneau qu'on jette autour des bouteilles. La peur, motif de la foire, est illustrée par la femme aux couteaux puis par le grand huit et les cris des gens. La bande sonore fait toujours état d'une prolifération de bruits : les pipes qui se cassent - le bruit de la carabine - les cris - les rires - et toujours l'orgue de foire qui domine avec la chanson populaire (on entend maintenant "Sous les ponts de Paris"). Le premier plan qui suit le générique nous donne une vision en légère plongée du manège en un large plan d'ensemble où la foule fourmille. Le plan suivant, plus serré, est celui de la caissière, Mme Moscat, propriétaire du manège. L'univers forain est comme une micro-société. Les relations entre les personnages mettent en avant une certaine forme de justice sociale (l'amiral venge Liliom - Julie a le droit de choisir une chanson car elle a déjà fait quatre tours - Liliom n'accepte pas de la renvoyer car les motifs ne sont pas fondés) mais aussi dénoncent certains comportements triviaux comme la rivalité que nous avons déjà évoquéé entre Julie et Mme Moscat ou entre Liliom et Hollinger. Nous pouvons aussi suggérer la rivalité entre Julie et son amie (La mine de Julie lorsque son amie se repoudre au passage de Liliom).Nous pouvons également citer la délation : Hollinger va avertir Mme Moscat du "manège" de Liliom avec Julie.

Liliom quitte le manège car il n'accepte pas d'être traité comme "la chose" de Mme Moscat et car il n'accepte pas d'être rabaissé par une femme devant d'autres femmes. Pourtant le manège est toute sa vie. En dehors de cet espace, il ne sait rien faire et même de vient un voyou. Mme Moscat a raison quand elle lui dira plus tard que les chevaux de bois lui manquent. Lui, cette sorte d'artiste, n'est rien en dehors du manège car il a besoin de se donner en spectacle pour être reconnu et aimé. La vision en plongée de Julie qui les voit discuter de chevaux et d'avions quand Mme Moscat tente de venir le récupérer nous donne à voir Liliom heureux à l'évocation de ces mots. A ce moment, elle sait qu'elle risque de le perdre et c'est ce qui lui donnera le courage d'avouer à Liliom son état. Car elle sent que le manège est incompatible avec leur amour. Dans le plan où le manège démarre sur la chanson "Gosse de gosse", Liliom balance les bras tantôt à droite, tantôt à gauche avant d'entamer la fredaine. Les statuettes d'Adam et Eve sont derrière lui, vision fracturée par le mouvement de ses bras mais aussi par le mât d'un cheval de bois qui coupe le cadre en son milieu. Pendant toute la durée du tour, le couple des statuettes sera séparé par ces mâts, comme pour nous prédire l'impossibilité de la relation amoureuse.
Liliom va avoir un enfant et c'est ce qui le décide a finalement renoncer à la proposition de Mme Moscat. Il réalise peut-être à ce moment qu'il doit tourner la page de l'univers ludique des manèges pour entrer dans celui de sa maturité. Mais un "mauvais garçon" peut-il se résoudre aussi facilement ?
L'enfant
Ce thème se pose en déclencheur. Grâce à lui, Liliom semble accepter de devenir un adulte. Mais il est vite désemparé. Et si Julie et lui n'ont jamais su se parler d'amour, ils auront encore plus de problèmes à parler de l'enfant. Ainsi Julie n'ose pas avouer qu'elle est enceinte et quand elle le fera, ce sera d'une manière furtive en se sauvant juste après. Quant à Liliom, il est heureux mais ne peut en parler à Julie. Il exulte de joie et communique même sa liesse à un chat noir (mauvais présage dans l'imagerie populaire". Mais dès que Julie apparaît, il se tait et va se coucher comme un enfant soudainement très fatigué en nous tournant le dos pour que nous ne voyons pas sa gêne. Julie, qui le materne depuis le début, le recouvre d'une couverture comme si effectivement il s'agissait d'un enfant.
La vie de Liliom est dorénavant calquée sur celle de son enfant. Lorsqu'Alfred lui dit qu'ils vont maintenant devoir se planquer pendant six mois, il projette déjà ce délai sur la naissance de son enfant. Quand il sera au ciel, il voudra savoir s'il aura un garçon ou une fille. Il dira tendrement "mon enfant". Mais néanmoins, il continuera à rejeter ses responsabilités quand on lui somme de reconnaître les faits.
A vrai dire, Julie et Lilom sont tous les deux des enfants. Julie a plu à Liliom car elle n'est pas une de ces femmes qui lui font peur, celles qui mettent en avant leur féminité. Julie est plus une femme-enfant et c'est là que s'opère son charme, sur son aspect infantile, rêveur, sur sa pureté (elle n'a jamais eu d'amoureux). Il l'appelle sa drôle de petite fille. Pour valider cette hypothèse, rappelons nous que Lang n'a pas hésité à faire jouer le rôle de Julie la fille par Madeleine Oseray qui joue aussi Julie la mère. Ambiguïté évidente lorsqu'on la découvre à l'écran. S'agit-il de la fille ? de la mère ? A vrai dire peu importe car elles sont toutes les deux des enfants.


Ainsi Liliom est le père et l'enfant de Julie la mère tandis que Julie la mère est la mère et l'enfant de Liliom, Julie la mère et Julie la fille étant identiques. Julie la fille chante "Gosse de gosse" et n'accepte pas qu'on dise du mal de son père autant que Julie la mère n'a jamais accepté qu'on dise du mal de Liliom. Finalement ils sont tous les trois des "gosses de gosses".
La mort
Elle est associée à l'amour. Le couteau d'Hollinger (la mort) vient se planter dans la pomme (l'amour). Julie dit à Liliom tout en fixant la caméra avec des yeux exorbités comme si elle annonçait une prophétie au monde entier (Voir Maria dans "Métropolis") : "Si j'aimais quelqu'un...je n'aurais peur de rien, pas même de mourir". Ce plan se clôt d'ailleurs par un fondu au noir assez long, pure mise en scène mais qui permet au spectateur de réfléchir, de voir autrement. But avoué de Lang à travers toute son oeuvre : distraire le public mais en même temps, instaurer en arrière-plan un espace et des thèmes de réflexion. On retrouve ce lien entre amour et mort dans "Les trois lumières" : "car l'amour est fort, aussi fort que la mort". Encore dans "Les trois lumières" : "celui qui n'a pas peur de sacrifier sa vie sera récompensé","celui qui offre sa vie la gagnera" dit la mort elle-même. C'est ce qu'a fait Liliom en offrant sa vie à la mort.
La mort est le moyen qu'a choisi Liliom pour échapper à la justice des hommes autant qu'à ses propres responsabilités. Mais a-t-il vraiment choisi la mort ou est-ce la mort qui l'a choisi ? Lorsqu'il se tue avec le couteau, son geste semble être celui d'un automate comme s'il était victime d'une hypnose, comme si ce n'était pas lui mais une force supérieure qui décide le bras à frapper le coup. Puis Liliom se lève sur le signe de la mort comme le couple à la fin des "trois lumières". Et comme la mort a appelé Liliom, ce dernier estime qu'elle doit maintenant le laisser tranquille. D'où sa réplique : "Maintenant que je suis mort, au moins qu'on me laisse tranquille". Il a suivi la mort mais elle n'a aucun droit sur lui, c'est tout au moins ce que pense Liliom. Pourtant la mort l'a enlevé pour son bien. Par le biais de la justice du ciel, Liliom va être réhabilité.
Il considère la mort comme un repos bien mérité. Mais ce serait trop facile : "Où serait donc la justice ? Ce serait trop commode si la mort arrangeait tout" disent les deux anges noirs. "Ce serait très commode d'être un homme à ce compte là". Le commissaire du ciel réitérera ces reproches.

L'esthétique un peu morbide du réalisme poétique s'exprime à travers tout le film et se pose en révélateur d'un pessimisme ambiant. Pour Lang, ce pessimisme est le fruit de son exil, l'obligation de quitter son pays pour échapper à l'empire du nazisme.
La justice
Lang avait inauguré ce thème avec M en instaurant la notion de 2 justices : celle du bas (la pègre dans la cave) et celle du haut (la police de la ville). Elles avaient le même mode de fonctionnement : tribunal, avocats...Mais la justice du bas était celle des hommes et celle du haut représentait les institutions. Cette dernière est lente (la police arrive sur les lieux où se trouve M alors que la pègre a presque terminé son jugement) et injuste (la police ne voit pas le malade qui sommeille dans le criminel). La première est plus rapide mais illégale. Dans "Liliom", la police du bas est lente et injuste : Liliom attend très longtemps. Il ne peut voir le commissaire. Un baron arrive qui a tous les droits. Lang caricature la justice d'une façon magistrale. Mais la morale donnée par Liliom est exacte : "la justice, c'est une affaire de faux-col". La police du haut, celle du ciel, a, à priori, le même mode de fonctionnement que celle du bas (interdictions, timbre humide,...) mais elle est rapide (immédiateté du procès) et juste (elle se rapporte aux faits réels par le biais du flash-back imposé à Liliom, incorporant ses pensées que l'on découvre dans cette deuxième partie). La police du ciel donne à l'homme une chance de se réhabiliter. On notera l'inversion des 2 justices par rapport à M. le Maudit. La justice plus humaine (quoiqu'au pays des morts) se trouve en haut tandis que la justice officielle se trouve en bas. La justice individuelle fait appel à la conscience de l'homme. Ainsi le flash-back imposé permet à la bande son d'exprimer la conscience de Liliom que ce mauvais garçon têtu refoulera dans un premier temps, laissant libre cours à sa mauvaise foi, même si un arrêt sur image à l'écran fige la vérité. Notons au passage que cette projection renvoie à la vidéo-surveillance de Métropolis. C'est un aspect visionnaire intéressant de ces deux films que de prédire avant l'heure l'usage qui sera fait de l'enregistrement d'images dans la surveillance des populations...

Quand Liliom acceptera finalement de donner sur terre au double de Julie quelque chose de beau, de très beau (voir comment il insiste souvent sur ces mots dans un regard pathétique), on comprend qu'il accepte de reconnaître ses erreurs. Mais, incorrigible, il se fâche. La balance de la justice a "bien du mal" à récupérer Liliom. C'est Julie qui amorcera la réhabilitation de Liliom en confiant : "oui, quelqu'un peut vous frapper sans vous faire du mal". Elle sait qu'il n'avait pas l'intention de faire mal. Julie a compris que l'incapacité à parler d'amour se transforme en violence masochiste car il souffre lui aussi (voir ses pensées : "Je me dégoûte...". Un des tout derniers plans révèlera cet amour non-dit et la tristesse d'avoir mal fait. Le plan où les larmes de Julie coulent sur les mains unies des deux femmes est lié par la bande son (petite musique aérienne au xylophone, chaque larme correspondant à une note) au plan suivant où l'on voit Liliom en plan serré, ému, les yeux humides. Cette liaison musicale suggère que les larmes qui tombent sur les mains de Julie pourraient bien être celles de Liliom. La musique se poursuit dans le plan suivant (avant-dernier plan) avec l'ajout de la grosse caisse qui rythme la progression ascensionnelle de la balance en faveur de Liliom. Le dernier plan incorpore dans la bande son le choeur pathétique des anges et une courbe de lumière atteint le paradis ou tout au moins un état supérieur : Liliom est vraiment racheté grâce à son émotion qui figure son repentir et son amour réel. La notion de conscience et de justice individuelle se retrouve dans "La rue rouge", remake de "La chienne" de Renoir où l'on dit : "Riez si vous voulez mais personne n'échappe à la punition. Nous avons tous un tribunal intérieur avec le juge et les bourreaux..." (la pègre pour M., le ciel pour Liliom)...Alors que fait-on ? On finit par se punir soi-même (le suicide de Liliom) et on ne peut pas fuir cela, jamais". Le juge du ciel représente donc l'expression de la conscience de Liliom.
La fatalité
Les actions des hommes sont déterminées par leur destin. C'est l'homme dominé par le monde. Il est le jouet des évènements.
- Ainsi Liliom est amené à se battre avec Hollinger : le couteau vient de se planter dans la pomme et inscrit le thème de la mort (La bible : "Le jour où tu en mangeras, tu deviendras passible de mort").
- Liliom doit servir d'arbître pour Mme Moscat : il perd son travail.
- Liliom est convoqué au commissariat : il rencontre Alfred qui lui sera de mauvais conseil.
- C'est Alfred qui vole le couteau mais il le place dans les mains de Liliom.
- Liliom veut confier son couteau au rémouleur, Alfred l'en empêche.
- Liliom est cerné par la police : il se tue (Notons que nous assistons à ce moment à un premier flash-back, sonore celui-ci).
Ainsi, à chaque fois Liliom est-il pris au piège. Les concours de circonstances se retournent toujours contre lui. Cette fatalité que subit Liliom est le traît d'unon avec Julie qui subit elle aussi la fatalité. Lorsque près du port Liliom discute avec les deux femmes pour savoir laquelle il retiendra, c'est une phrase de l'amie qui déclenchera son choix. Cette dernière explique à Liliom que si Julie rentre tard, ses patrons la mettront à la porte. "Moi aussi on m'a mis à la porte" rétorque-t-il. julie n'a prononcé qu'un mot en reconnaissance : "Oui". Liliom regarde Julie, fait quelques pas en avant et s'arrête. La caméra subjective nous renseigne : c'est à ce moment précis qu'il voit Julie, pour la première fois. Ce destin difficile qu'ils ont en commun consumme leur premier regard réellement amoureux. L'amie n'existe plus, d'ailleurs elle disparaît du champ. Deux plans plus loin, alors qu'ils sont tous les deux assis sur le banc, Liliom lui dit : "Nous voila pareils ce soir, à la porte tous les deux".
On couclura ce travail d'approche du film en prenant appui sur le dernier plan qui est en fait la somme des deux précédents. Les larmes et l'amour se métamorphosent en un bouquet final totalement poétique et féerique. L'émotion est à son comble et pourtant elle prend naissance dans le rationalisme de la mise en scène langienne où absolument rien n'est laissé au hasard. Ainsi de ses exigences légendaires, de son plan de travail si rigoureux naîtra ce petit chef d'oeuvre (avis généralement non partagé) où le réel se transforme en légèreté féerique.
Catherine Gheselle
10/97
commenter cet article …



 Le mal et le mâââle : Vincent Cassel dans Doberman
Le mal et le mâââle : Vincent Cassel dans Doberman

 Metteur en scène et directeur d'acteurs déterminé
Metteur en scène et directeur d'acteurs déterminé



/idata%2F0190722%2Fpoints-de-vue%2Fvalllee-louron.jpg)
/idata%2F0190722%2Fnoir-et-blanc%2Fny001.jpg)
/idata%2F0190722%2Fvoyage-au-japon%2Fvalllee-louron.jpg)
/idata%2F0190722%2Fkollageskitsch%2Fyeux11.jpg)
/idata%2F0190722%2Fd---gouts-et-des-couleurs%2Fusinepontamousson.jpg)